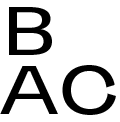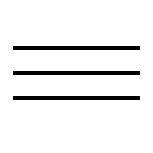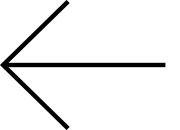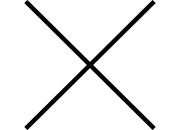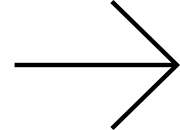Artiste exposé un peu partout dans le monde puis près de 30 ans, Philippe Huart n’avait encore jamais fait l’objet d’une exposition dans la région bordelaise. Avec «En l’état des choses», le Centre d’Art contemporain Château Lescombes de la ville d’Eysines répare cette lacune en proposant, du 30 juillet au 26 septembre 2021, une plongée rétrospective dans l’œuvre aussi pop qu’anxiogène de ce maître de l’hyperréalisme. Rencontre.
_______________
Avant de devenir plasticien, vous avez eu une première vie en tant qu’illustrateur. Après votre diplôme à l’École supérieure des Arts Modernes de Paris en 1973, vous avez notamment travaillé pour la publicité et dans la conception de pochettes de disque (Gainsbourg, Birkin …). Pouvez-vous revenir sur cette période ?
Je peins depuis toujours. Si ma formation de graphiste m’a bien évidemment servi pour la conception des pochettes de disques, le lien s’est fait par mon intérêt pour la musique. Le hasard a voulu que l’une de mes premières commandes d’illustration soit une pochette, j’ai pu développer cette voie par la suite ce qui me permettait de pouvoir peindre en parallèle.
Comment s’est fait le passage de votre carrière d’illustrateur à celui d’artiste?
La conception des pochettes a pris davantage d’essor, ce qui ne me laissait moins de temps pour peindre. L’industrie phonographique mutait dans le même temps vers un esprit beaucoup plus commercial, je ne trouvais plus de satisfaction à concevoir des images imposées. J’avais la frustration de ne plus pouvoir donner un sens aux pochettes et de devoir me plier aux exigences des maisons de disques. À cette période, je montrais déjà mes tableaux dans différents salons comme « Jeune peinture », « Grands et Jeunes », « Comparaison » et la transition a pu ainsi se faire naturellement. Je commençais aussi à nouer des contacts avec des galeries qui suivaient l’évolution de ma peinture.
Quand on regarde vos tableaux des plus anciens et ceux d’aujourd’hui, on constate que vous avez toujours opté pour un rendu hyperréaliste dans vos œuvres. Que recherchez-vous en brouillant le rapport entre la photographie et peinture ?
Ma technique a toujours été réaliste, je ne peux que peindre (ou dessiner) de cette façon. Ce n’est pas un choix délibéré, c’est juste un état de fait. J’aime travailler sur la perception du réel pour provoquer quelque-chose chez le spectateur. Je m’empare de la réalité, pour la transposer de façon fantasmatique et angoissante. Le critique d’art Renaud Faroux voit mes tableaux comme des « fictions du quotidien» mêlant souffrance et extase, deux extrêmes de la condition humaine… »
Comment se déroule votre processus créatif? Travaillez-vous plusieurs toiles en même temps, fonctionnez-vous par série ?
Je fonctionne par série, mais je réalise toujours une toile à la fois. Quand me vient une idée, je la développe sur un certain nombre de peintures. Cela peut être le thème des addictions autour du motif récurrent des gélules/bonbons, celui des contradictions et des doubles-sens que l’on donne aux choses, ou le travail autour de la représentation des armes. Lorsque j’atteins une certaine saturation de mon sujet, la série s’arrête à l’exception des gélules qui reviennent de manière cyclique à travers différentes séries.
Vos toiles s’inscrivent dans la mouvance du Pop art, mais aussi avec la dimension plus politique et critique héritée de la Figuration Narrative. Est-il juste de vous associer à ces mouvements ?
Si mon travail peut évoquer le Pop art, cela vient sans doute du fait de mes nombreux voyages aux États-Unis et de l’influence esthétique américaine, mais c’est avant tout une référence, comme peut l’être la Figuration narrative. J’ai la chance de connaître certains artistes tels Bernard Rancillac et Gérard Schlosser, mes parrains de peinture, qui m’ont toujours encouragé et soutenu.
Le public a besoin de repères, et l’association à des mouvements connus peut aider à la compréhension d’une œuvre, mais à mon sens, il n’y a pourtant aucune légitimité a m’associer à ces courants.
Vous composez certaines de vos toiles comme des mosaïques. Vous utilisez parfois le gros plan, le très gros plan dans vos tableaux, des superpositions ou des juxtapositions d’images. Que cherchez-vous à créer en reliant ces fragments d’images ? Voulez-vous donner une dimension cinématographique ou narrative à votre travail ?
Le fractionnement d’images est une résurgence de mes années de formation à l’Esam [École Supérieure des Arts Modernes, ndlr.] où les cours étaient basés sur ceux de Johannes Itten du Bauhaus.
J’utilise souvent deux images en apparence antinomique qui assemblées donnent au spectateur-regardeur une information qui lui permettra éventuellement de trouver un sens narratif. Cela peut aussi être à l’aide d’un mot placé au centre de la toile ou par son titre. Je cherche à créer une uniformité en m’emparant d’ informations visuelles ou d’objets disparates. En les reliant, je les isole pour leur apporter une dimension métaphorique. J’aime jouer sur l’ambiguïté des représentations. La reproduction fidèle de l’image m’importe moins que ce que celle-ci induit. En détournant le monde clinquant de la publicité pour peindre des pilules, des fils barbelés et des instruments chirurgicaux, j’essaye de réfléchir sur ce qu’est le réel qui nous entoure.
Vous abandonnez parfois l’huile pour le dessin graphite et la pierre noire. Qu’est-ce qui vous fait choisir un outil plutôt qu’un autre ?
Depuis quelques années, je développe la pratique du dessin d’une manière aboutie où je prends grand plaisir à me perdre dans les textures des plis de la peau, du textile ou des méandres de l’eau. Je ne fais pas de différence dans les pratiques. Que ce soit peinture ou dessin, j’aborde les mêmes sujets.
Vos premiers tableaux présentaient déjà des personnes encagoulés, masqués. La crise sanitaire et la menace terroriste donnent une nouvelle résonance presque prophétique à certaines de vos oeuvres…
L’irruption de la pandémie de Covid-19 a-t-elle eu un impact sur l’évolution de votre travail ?
Comme vous le dites, mes premiers tableaux représentaient ces personnages masqués, ces sujets ont toujours été présents dans mon travail. Il se trouve qu’aujourd’hui cela devient malheureusement un sujet d’actualité, mais je ne pense pas avoir un don de prémonition !
Un mot sur vos projets ?
Je prépare depuis un certain temps des dessins autour du thème de l’abysse, les remous que peuvent créer la mer. Comme le dit le peintre maudit dans le film de Marcel Carné, Le Quai des brumes, tout mon travail est basé sur le fait de peindre (ou dessiner) les « choses derrière les choses ».
Propos recueillis par Nicolas Trespallé