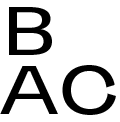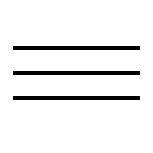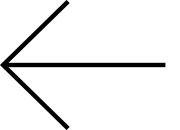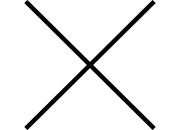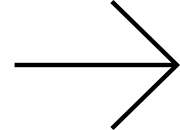EXIT
Tel est l’intitulé que se sont appropriés les étudiants, aujourd’hui diplômés en art, mention design pour nommer l’exposition de leurs travaux, proposée aux regards d’un public plus large que le seul jury de professionnels qui a délibéré sur leur statut au mois de juin dernier.
La sortie de l’école, tous les étudiants y aspirent avec cette envie d’apprendre et de continuer leur formation dans un vrai contexte professionnel. Un contexte qu’ils vont enrichir de leur personnalité, de leur vision et de leurs recherches.
À la sortie, tout démarre, tout reste à apprendre.
Quatre diplômes son présentés, reflétant certains enjeux du design qui se déploient dans des pratiques situées et signifiantes, explorant par le graphisme, l’édition, le dessin ou la scénographie urbaine, les questions révélées par une actualité contemporaine en plein bouleversement.
Économie globalisée, décroissance ou croissance, « gender studies », écosystèmes urbains, un questionnement inévitable aujourd’hui mais qui prends, peut-être un autre sens au sein d’un cursus d’une école d’art et de design qui peut générer des situations d’utopie.
Alix Caumont, Jérémie Nardella, Kexin Qi, Maria Luisa Rojano
L’approche d’Alix Caumont, sur ces sujets, est double. D’une part, il révèle, par l’observation dans le cadre d’un travail ponctuel de cariste dans un entrepôt de grande distribution, un habitat où l’individu vivrait comme dans un lieu de stockage. Un stockage de ses biens personnels et du quotidien. Ce lieu étant lui-même partie intégrante d’un ensemble, monumental, d’habitats collectifs. Chaque ensemble étant intégré à une trame urbaine à l’échelle d’une cité sans limites. Les maquettes d’Alix Caumont nous confrontent à une certaine dystopie de nos comportements. Le second projet aborde un tout autre débat : celui où une pratique décroissante peut entrainer sa propre récupération par l’industrie du luxe, une des activités les plus florissante du secteur boursier. Alix Caumont est un marcheur (au sens propre) et grand utilisateur de snickers. Sa pratique et son observation l’amène à réfléchir et à concevoir une économie du recyclage. Il conçoit ses chaussures à partir d’éléments pris à d’autres chaussures qu’il a démonté. Si l’enjeu d’une pratique écologique et démocratique conduit ce travail, il n’en pose pas moins la question du positionnement de l’objet conçu et du registre dans lequel il se situe, multiple ou pièce unique, marché global ou marché de l’art ?
Jérémie Nardella se revendique de son appartenance à la communauté des gens du voyage. Par des installations de réalité virtuelle et augmentée, il nous entraine dans une scénographie qui ressemble à une fête foraine. Nous entrons alors dans quatre mondes révélant chacun des désirs ou revendications propres. Le premier se met au service la communauté Queer et de ses acteurs. Cette communauté souffrant d’un ostracisme quotidien s’est vu supprimer par le confinement les lieux qui lui permettent d’exister, les lieux de la nuit. Jérémie Nardella propose la conception et la réalisation de masques virtuels au moyen d’un smartphone permettant de mettre en scène sa propre transformation et d’aller l’exhiber, sans sortir de chez lui, dans un second espace virtuel interagissant avec d’autres lieux et corps au son de la musique. Communautés souvent décriées comme celles de « voleurs de poules », les gens du voyage subissent depuis des millénaires la méfiance et les insultes, si ce n’est leur extermination programmée, pour cause de leur non-sédentarisation. Dans un troisième espace, Jérémie Nardella nous invite à un jeu de rôle où nous prenons la forme d’un lapin qui s’immisce dans les méandres de préjugés, souvent hostiles, de communautés fermées de la banlieue bordelaise. Le dernier monde qu’il nous propose d’explorer est une sorte d’itinérance sans fin, à travers des mondes oniriques, à la recherche d’un point géographique indéfinissable. Peut-être à l’image de cette communauté qui n’a jamais eu de revendications territoriales.
Kexin Qi nous présente deux scénographies urbaines. Elle nous invite, en plein cœur de Bordeaux, place des Quinconces, au-dessus du pôle d’échanges du tramway, à prendre quelques minutes de nos parcours programmés, pour effectuer une promenade dans la canopée des arbres qui poussent tout au long des voies et qui aboutissent au bord de la Garonne. Cette réflexion ne s’inscrit pas dans cette tendance à la végétalisation de nos cités mais tentent une optimisation de l’existant. Le parcours proposé est ponctué de stations, sous la forme de microarchitectures, où l’on peut regarder le ciel, observer la nidification des oiseaux ou tout simplement contempler les courants de la Garonne. Un parcours pour notre santé psychique où l’on peut s’adonner à la rêverie. Toujours dans une approche d’ornithologie urbaine, Kexin Qi réalise des scénographies à l’attention des oiseaux. Dispersées dans les parcs bordelais, elles agissent à la fois comme des points de repères et de protection d’une partie de la faune urbaine.
Maria Luisa Rojano est engagée et souhaite développer un travail graphique d’utilité publique. Originaire de Colombie, elle nous parle de son pays avec un regard sans concession sur le statut de la femme colombienne face à la violence dont elle est souvent la victime par les féminicides en hausse constante dans le pays. Maria Luisa Rojano nous parle de traditions musicales avec les rythmes de Salsa dont les paroles chantées sont de véritable appel à la culpabilisation et au meurtre des femmes et entrent insidieusement dans les foyers par les playlist. Mala Mujer (mauvaise femme) est l’intitulé d’une série d’affiches dénonçant cet état de fait. Sa démarche graphique est aussi de donner un sens et une représentation visuelle à des données abstraites comme le parcours d’un-e immigré-e face aux vicissitudes tant administratives qu’économiques quand on tente de s’arrimer à une terre d’accueil. La cartographie ressentie est un outil de représentation d’un parcours de vie et Maria Luisa Rojano nous propose d’approcher le sien et celui de sa famille proche.