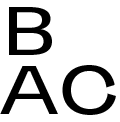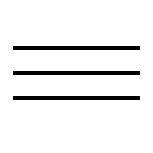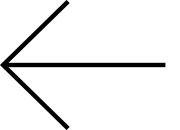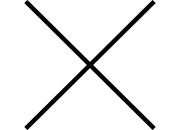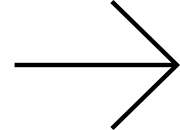Les œuvres de Michel Herreria apparaissent d’abord sur ce fond noir, pas totalement opaque, mais mat et dense, parfois comme une sorte de quadrillage en nuances de gris. De là, les personnages prennent place, se distinguent par une ligne blanche, rarement claire. Les profils comme les gestes sont vibratoires, hésitants, imprécis. Les personnages eux-mêmes sont troubles, doubles, triples… ils se confondent. Ils regardent autour d’eux, lèvent la tête pour observer ou écouter. D’autres, plus imposants mais plus imprécis s’adressent à eux en se penchant. Grosse tête qui parle à de plus petites. Jeu de domination, d’informations qui circulent, d’injonctions, prescriptions, sermonts prononcés… Théâtre du quotidien, arêne de travailleurs envahis par un « impitoyable esprit de sérieux » dont Theodor Adorno (Minima moralia) rappelle qu’il soutient le déploiement d’« activités de façade ». Michel Herreria de cesse de superposer des plans, plan colorés qui entourent et divisent de sombres acteurs. Activités de façade, de médiations, de médiations de médiations… La vie moderne ; notre vie moderne.
Et puis viennent les couleurs dont on pourrait dire qu’elles appartiennent à celles du Moyen- Âge. Cette vivacité qui se détache d’un fond inexorablement noir est saisissante. Elle rappelle les enluminures, miniatures de scènes figurées, d’images insérées, cartouches et bandeaux. Le rouge, le bleu, l’orangé et le vert dominent. Respectivement oxide de plomb, l ‘oxyde de cobalt, le mercure, l’arsenic, le cuivre… toute une chimie dont Michel Herreria reprend les codes.
Les peintures sur papier de Michel Herreria déroulent des espaces infinis, dont « le centre est partout, la circonférence nulle part » comme l’écrit Pascal (Pensée I). Personnages en prise avec leurs vaines prétentions, soumis à des injonctions qui relèvent de leur propres imaginaires, se débattant comme de pauvres diables dans le magma inconsistant de la réalité sociale… cette étrange satire qui nous est présentée ici ressemble à une suite de stations, stations de nos passions, de nos errances quotidiennes.
« Effranger le monde », c’est laisser couler, ruisseler depuis les miniatures qui se dispersent comme des centres perdus dans un espace infini… jusqu’au bord du plan ou de la page. Peindre c’est écrire, écrire c’est aussi peindre d’une certaine façon. C’est en tout cas ouvrir les pages d’un étrange roman, roman moderne dont le héros, face au monde infini, n’a plus que ce seul tourment « de la créature condamnée à être seule et qui se consume en quête d’une communauté » (Lukacs, Théorie du roman)
Jérôme Diacre
Enseignant de philosophie, critique d’art et commissaire d’exposition